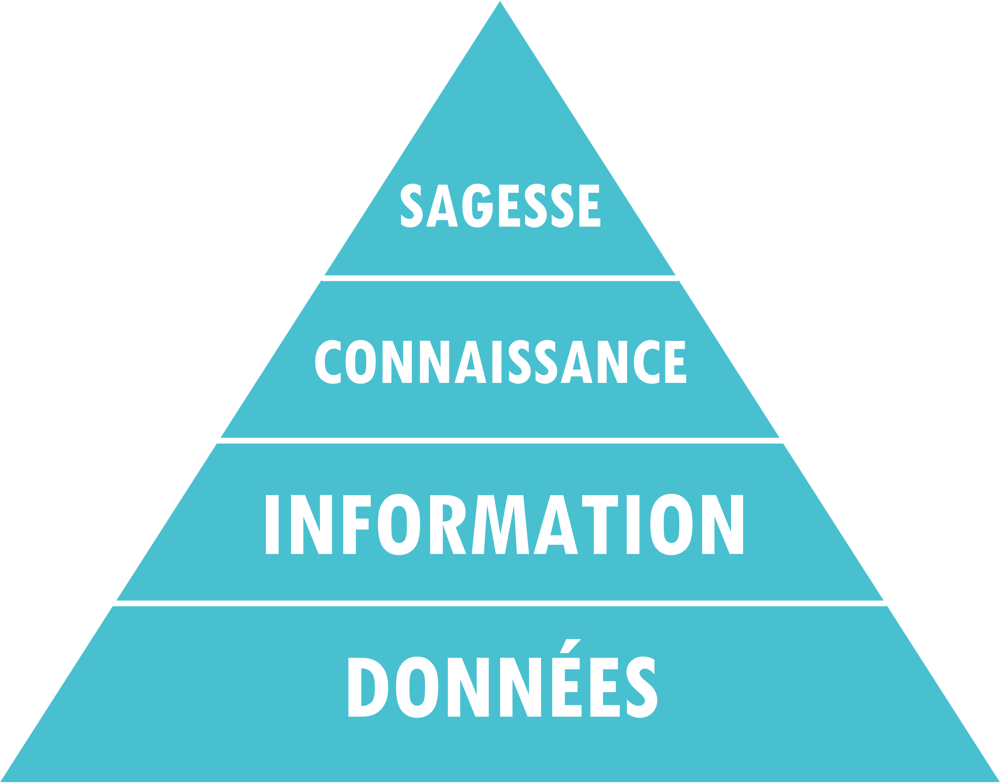4. Pouvoir et information : asymétries, désinformation, censure, surveillance
Parce que l’information confère du pouvoir, sa maîtrise fait l’objet de
luttes et d’
enjeux de contrôle au sein de la société. Ne pas avoir accès à une information que d’autres possèdent, ou au contraire être manipulé par de fausses informations, peut placer un individu ou un groupe en situation de faiblesse. Dans cette section, nous abordons plusieurs phénomènes où le rapport de pouvoir est lié à l’information :
l’asymétrie informationnelle,
la désinformation,
la censure et
la surveillance.
4.1 Asymétries informationnelles : savoir, c’est pouvoir… pour certains
Le concept d’
asymétrie d’information vient de l’économie, où il décrit une situation d’échange dans laquelle une partie détient plus d’informations qu’une autre. Dans un marché, par exemple, le vendeur peut connaître des défauts d’un produit que l’acheteur ignore, ce qui lui donne un avantage injuste. De manière générale, « l’asymétrie d’information correspond à la situation dans laquelle un des partenaires à l’échange dispose de plus d’informations que l’autre partie »
schoolmouv.fr
Cette asymétrie crée un
déséquilibre de pouvoir. Celui qui sait peut tirer profit de celui qui ne sait pas, ou orienter la décision dans son intérêt. Le concept a été popularisé par l’économiste George Akerlof dans son article sur le « marché des lemons » (1970) : il montrait que si les acheteurs de voitures d’occasion ne savent pas distinguer une bonne voiture d’une « lemon » (citron, argot pour une épave), les vendeurs véreux en profitent, ce qui finit par faire chuter la confiance et la qualité moyenne sur le marché. C’est pourquoi introduire de la transparence (par exemple un carnet d’entretien vérifié, un contrôle technique public) peut rétablir la confiance et l’efficacité du marché. On voit ici qu’une
meilleure diffusion de l’information (réduisant l’asymétrie) est bénéfique collectivement.
Les asymétries informationnelles ne concernent pas que les transactions marchandes. En politique, on peut parler d’asymétrie d’information entre les gouvernants et les citoyens : les gouvernants ont accès à des données, des analyses confidentielles dont le public ne dispose pas, ce qui rend le contrôle démocratique plus difficile. D’où l’importance de la
transparence et de la
presse d’investigation pour réduire cette asymétrie et permettre aux citoyens de savoir ce qui se fait en leur nom. Dans le domaine de la santé, il existait historiquement une forte asymétrie entre le médecin (détenteur du savoir médical) et le patient profane. Aujourd’hui, avec Internet, les patients ont accès à beaucoup d’informations, ce qui tend à rééquilibrer partiellement la relation (même si le médecin reste l’expert).
Cependant, toute asymétrie n’est pas nécessairement illégitime : certaines sont temporaires ou liées à l’expertise. Le vrai problème est quand l’asymétrie est entretenue délibérément par l’une des parties pour conserver un pouvoir. Par exemple, une entreprise peut dissimuler des informations nuisibles (pollutions, dangers d’un produit) pour éviter des poursuites – on a vu cela avec l’industrie du tabac qui connaissait les effets cancérigènes bien avant que le public en soit informé. Là, l’asymétrie sert un
rapport de domination et cause un tort collectif.
Dans les sociétés occidentales modernes, il existe de nombreux
mécanismes pour limiter les asymétries : lois sur l’étiquetage des produits, obligations pour les sociétés cotées en bourse de publier leurs comptes, procédures de concertation publique, etc. Ces mécanismes visent à rendre l’information plus symétriquement disponible. Néanmoins, à l’ère du
numérique, de nouvelles asymétries apparaissent. Par exemple, les grandes plateformes Internet (GAFA) accumulent des quantités massives de
données sur les utilisateurs (données de navigation, de localisation, historiques d’achats, etc.) et ces utilisateurs n’ont souvent qu’une idée très vague de ce qui est collecté et comment c’est utilisé. Cette asymétrie d’information entre l’individu et les géants du numérique confère à ces derniers un pouvoir d’influence considérable (profilage publicitaire, capacité à anticiper les comportements, etc.). C’est une préoccupation majeure en termes de vie privée et de pouvoir de marché, qui pousse à réclamer plus de transparence de la part des entreprises tech.
En résumé, les asymétries informationnelles rappellent que
la distribution inégale du savoir crée du pouvoir inégal. Combattre ces asymétries par la transparence, l’éducation et l’accès pour tous à l’information est un enjeu démocratique et éthique important, afin que l’information ne devienne pas une source d’oppression des uns par les autres.
4.2 Désinformation : manipuler l’opinion par de fausses informations
Si l’information est une arme, il est tentant pour certains d’en fausser la trajectoire. La
désinformation désigne l’ensemble des pratiques consistant à diffuser délibérément de fausses informations ou des informations biaisées dans le but d’influencer l’opinion ou de servir un intérêt particulier
fr.wikipedia.org
Il s’agit d’une forme de
manipulation de l’information, volontaire, à ne pas confondre avec la simple mésinformation (erreur non intentionnelle). La désinformation se rapproche de notions comme la
propagande, les
rumeurs ou les
« fake news », même s’il y a des distinctions subtiles dans les motivations et les cibles
fr.wikipedia.org
Historiquement, la désinformation n’a rien de nouveau. Les stratèges militaires de l’Antiquité, comme Sun Tzu, évoquaient déjà l’usage d’informations trompeuses pour induire l’ennemi en erreur
fr.wikipedia.org
Au XXe siècle, la propagande d’État pendant les guerres mondiales et la Guerre froide a constitué de vastes entreprises de désinformation (utilisation de médias contrôlés pour diffuser de la fausse nouvelle, mise en scène mensongère, réécriture de l’histoire, etc.). Walter Lippmann dès 1922 parlait de « fabrique du consentement » pour décrire comment l’opinion publique pouvait être modelée par des récits simplifiés ou biaisés
fr.wikipedia.org
Edward Bernays, en 1928, théorisait dans Propaganda l’art d’influencer les masses par les relations publiques et la publicité
fr.wikipedia.org
Dans les régimes autoritaires, la désinformation est un outil assumé du pouvoir, qui contrôle les médias et diffuse une version officielle déformée de la réalité. Mais même les démocraties libérales y recourent parfois, de manière plus subtile, par exemple sous forme de « spin » (communication politique qui présente les faits sous un angle très orienté) ou d’opérations d’influence menées par des services de renseignement.
Aujourd’hui, le terme de désinformation est surtout mis en avant dans le contexte d’Internet et des réseaux sociaux. Le phénomène des fake news a pris de l’ampleur : des contenus mensongers circulent virale-ment en ligne, parfois diffusés par des
bots ou des groupes organisés, brouillant la frontière entre le vrai et le faux. Des campagnes de désinformation à grande échelle ont été documentées, par exemple lors de l’élection américaine de 2016 ou de la campagne du Brexit, où de faux comptes et des sites louches ont propagé des théories complotistes ou des fausses nouvelles pour polariser l’opinion. L’affaire
Cambridge Analytica (2018) a mis en lumière comment des données personnelles de millions d’utilisateurs Facebook avaient été utilisées pour cibler des messages politiquement biaisés, illustrant une intersection perverse entre asymétrie informationnelle et désinformation.
La désinformation pose un défi grave car elle
sape la confiance dans l’information. Si les individus ne savent plus distinguer le vrai du faux, le débat public rationnel devient impossible et l’opinion peut être instrumentalisée à merci. De plus, la désinformation exploite souvent les
biais cognitifs humains – par exemple, une fausse nouvelle sensationnaliste se propage plus vite qu’un démenti factuel plus nuancé (biais de négativité, biais de confirmation, etc.). Les réseaux sociaux, en privilégiant l’engagement émotionnel, peuvent favoriser involontairement la diffusion de ces contenus trompeurs.
Face à ce danger, plusieurs contre-mesures sont discutées ou mises en place en Occident :
- Le fact-checking : de nombreux médias ont des rubriques de vérification des faits, et des organisations indépendantes (comme les Décodeurs du Monde en France, ou FactCheck.org aux USA) analysent et réfutent les fausses affirmations circulant publiquement.
- Les régulations des plateformes : l’Union Européenne par exemple a adopté un plan de lutte contre la manipulation de l’information en ligne, encourageant les réseaux sociaux à retirer plus vite les faux comptes, à limiter la portée des fausses infos virales, etc.
centredecrise.be
C’est un équilibre délicat avec la liberté d’expression, mais la tendance est à la responsabilisation accrue des diffuseurs d’information.
- L’éducation aux médias : former les citoyens, dès l’école, à exercer leur esprit critique face aux informations, à reconnaître les techniques de désinformation (par exemple, l’usage de faux experts, de chiffres hors contexte, de théories du complot, etc.
Des guides pratiques et des cours visent à « inoculer » les esprits contre la désinformation en apprenant à repérer les signes d’une infox.
Il faut noter qu’accuser de « désinformation » une information dérangeante peut aussi devenir une arme politique – d’où l’importance d’avoir des
références indépendantes pour trancher. L’idéal démocratique est un
écosystème informationnel où la pluralité des médias et la vigilance citoyenne permettent de filtrer progressivement les mensonges. C’est un combat permanent, car les désinformateurs innovent sans cesse (deepfakes, usines à trolls, etc.). L’issue de ce combat sera déterminante pour l’empouvoirement collectif : une population noyée dans la désinformation perd son pouvoir d’agir (on l’a vu tragiquement pendant la pandémie de COVID-19, où de fausses rumeurs sanitaires ont coûté des vies en dissuadant des personnes de se faire soigner correctement). En revanche, une population éduquée à l’esprit critique et avec des médias intègres résiste mieux aux manipulations et peut faire des choix plus libres.
4.3 Censure : priver d’information pour contrôler
La
censure consiste, pour un pouvoir (politique, religieux, économique), à interdire ou limiter la diffusion d’informations ou d’expressions jugées indésirables. « La censure est la limitation de la liberté d'expression par un pouvoir […] sur des livres, médias ou œuvres d'art, avant ou après leur diffusion »
fr.wikipedia.org
C’est donc le pendant direct de la liberté d’informer et d’être informé. Là où la désinformation inonde d’informations fausses, la censure assèche le flot d’informations disponibles en bloquant celles qui dérangent.
Dans l’histoire occidentale, la censure a longtemps été la norme : l’Église, par exemple, a établi dès la Renaissance un
Index des livres interdits pour empêcher la diffusion des ouvrages contraires à la doctrine catholique. De nombreux régimes monarchiques ou impériaux contrôlaient étroitement la presse et l’édition, via des censeurs officiels. Il a fallu des luttes politiques pour conquérir la
liberté de la presse. La France, par exemple, n’a vraiment garanti cette liberté qu’avec la loi du 29 juillet 1881, issue du combat des républicains et des militants d’éducation populaire (la Ligue de l’enseignement notamment)
journals.openedition.org
Cette loi a supprimé le régime de censure préalable et posé le principe que l’on peut publier librement, sous réserve de répondre après coup de ses abus éventuels devant la justice (diffamation, incitation à la violence, etc.). Elle a été un pilier de la démocratie française, même si dans les faits la censure a pu ressurgir ponctuellement (en temps de guerre, par exemple, la presse a été contrôlée).
La censure peut prendre plusieurs formes :
- Directe : interdiction explicite d’un journal, d’un livre, d’un film ; caviardage de passages ; blocage d’un site web ; emprisonnement ou sanction de journalistes pour les réduire au silence.
- Indirecte : pression économique (un gouvernement ou une entreprise retire ses annonces publicitaires pour asphyxier un média trop critique), concentration des médias entre quelques mains amies du pouvoir, ce qui limite la pluralité (certains auteurs parlent de « censure indirecte non-officielle sous forme de pression due à la concentration des médias »
fr.wikipedia.org
Il y a aussi l’
autocensure : par crainte de représailles ou pour plaire à sa hiérarchie, un journaliste ou un éditeur va s’abstenir de publier certains sujets sensibles
fr.wikipedia.org
Dans de nombreuses régions du monde aujourd’hui, la censure d’Internet est courante : la
cybercensure empêche l’accès à des informations politiques (sites d’opposition bloqués), filtrage de réseaux sociaux, etc. Les pays comme la Chine, la Russie, l’Iran, ont mis en place des systèmes sophistiqués pour contrôler ce que les citoyens peuvent voir en ligne. Ces mesures s’accompagnent souvent de campagnes de propagande (désinformation) locales pour remplir le vide. On le voit, censure et désinformation vont souvent de pair comme outils de contrôle : supprimer les voix dissidentes et amplifier les voix favorables.
En Occident, si la censure étatique est officiellement bannie (sauf exceptions légales très précises : incitation à la haine, apologie du terrorisme...), on s’inquiète de nouvelles formes de censure liées aux plateformes numériques. Par exemple, les
algorithmes de Facebook ou YouTube, en décidant quels contenus mettre en avant ou retirer (notamment via les règles de modération interne), exercent un pouvoir de fait sur la visibilité de l’information. Une décision de Facebook peut « déréférencer » un média alternatif et le faire quasiment disparaître du paysage pour de nombreux lecteurs – certains parlent de “déréférencement” ou “dévitalisation” comme d’une censure 2.0. La difficulté ici est que ces entreprises privées ne sont pas soumises exactement aux mêmes exigences que l’État, et le débat est vif pour savoir comment garantir la liberté d’expression à l’ère des plateformes globales.
Pourquoi le pouvoir censure-t-il ? Essentiellement pour
maîtriser le récit et conserver son emprise. En empêchant la diffusion d’idées révolutionnaires, on freine les révolutions ; en cachant les scandales, on évite l’indignation publique ; en muselant la presse indépendante, on peut gouverner sans contre-poids. La censure est efficace à court terme pour maintenir le statu quo, mais souvent au prix d’un ressentiment croissant et d’un appauvrissement intellectuel de la société. L’exemple du bloc de l’Est pendant la Guerre froide est parlant : la censure y était forte, mais les citoyens se méfiaient de la propagande officielle et cherchaient avidement les samizdats (copies clandestines de livres interdits) et écoutaient les radios étrangères. L’information finit par trouver des brèches (d’où l’image de l’« underground » pour les circuits d’information clandestins).
En démocratie, la vigilance reste de mise contre toute tentation de censure excessive. Les enjeux de sécurité (lutte contre le terrorisme, etc.) ont parfois conduit à des lois de surveillance ou de censure qui inquiètent les défenseurs des libertés. Par exemple, bloquer administrativement des sites web sans décision de justice (pratique apparue dans certains pays contre des sites djihadistes) ouvre une brèche dans le principe de la liberté de communication. Il y a un équilibre délicat entre protéger le public (contre la haine, la violence) et préserver un débat libre. C’est un débat actuel dans nos sociétés, particulièrement à l’ère du numérique où l’information circule de façon anarchique.
En résumé, la censure est l’expression la plus brute de l’axiome « l’information, c’est le pouvoir » – celui qui a le pouvoir s’arroge le contrôle de l’information pour le conserver. À l’opposé, une société qui valorise l’empouvoirement individuel et collectif cherchera à minimiser la censure, et à garantir au contraire le
droit de savoir et le
droit de communiquer. C’est la base d’un citoyen capable et d’une communauté vivante.
4.4 Surveillance : information sur les individus et contrôle social
Le dernier enjeu de pouvoir que nous traiterons est la
surveillance, qui est en quelque sorte l’asymétrie informationnelle poussée à l’extrême : un acteur (souvent l’État, ou des entreprises) collecte un maximum d’informations sur les individus, sans réciprocité, afin de les contrôler ou de les influencer. L’image du
Panoptique, conceptualisée par Jeremy Bentham au XVIIIe siècle et analysée par Michel Foucault, est souvent utilisée pour représenter la surveillance. Dans une prison panoptique, un surveillant peut observer tous les prisonniers depuis une tour centrale sans être vu ; les détenus ne savent pas quand ils sont observés, ils intègrent donc cette possibilité et finissent par
s’auto-discipliner en permanence
books.openedition.org
Foucault a montré que ce principe s’étend symboliquement à la société disciplinaire moderne – écoles, usines, hôpitaux – où la surveillance diffuse incite chacun à se conformer aux normes.
Aujourd’hui, avec la révolution numérique, on parle de « société de surveillance » ou de « société de contrôle » (selon l’expression de Gilles Deleuze prolongeant Foucault) pour décrire un état où la surveillance devient omniprésente et continue, grâce aux technologies
books.openedition.org
Nos moindres faits et gestes laissent des
traces numériques (transactions par carte, localisation de notre téléphone, historiques web, caméras de vidéosurveillance urbaines, etc.). Ces traces forment des Big Data qui peuvent être analysées. La promesse utopique d’une « société de l’information » fluide et participative s’est en partie muée en ce constat : « le déploiement des technologies numériques assure la géolocalisation, la captation et la capitalisation des traces laissées par les internautes sur le web », contribuant à l’instauration d’une « société de contrôle et de surveillance »
books.openedition.org
Les États disposent maintenant d’outils de
surveillance de masse autrefois inimaginables. Les révélations d’Edward Snowden en 2013 ont montré que les agences de renseignement occidentales (la NSA aux États-Unis, le GCHQ en Angleterre, etc.) aspiraient et stockaient des volumes gigantesques de données de communication, souvent sans discrimination, par souci de sécurité nationale. Officiellement, c’est pour détecter des menaces terroristes, mais le potentiel de dérive est là : un gouvernement mal intentionné pourrait utiliser ces informations pour surveiller les opposants politiques, pour instaurer un état policier où chaque individu se sait potentiellement observé. Même sans aller jusque-là, la simple conscience d’être surveillé peut avoir un
effet dissuasif sur l’expression libre (on parle d’
effet panoptique ou de chilling effect). Par exemple, si je sais que mes recherches internet sont enregistrées, j’hésiterai peut-être à me renseigner sur des sujets controversés.
La surveillance n’est pas que le fait des États. Les entreprises du numérique nous
profilent pour la publicité ciblée ; nos objets connectés mesurent nos données de santé ; dans certaines villes on teste la
reconnaissance faciale automatisée pour identifier les passants. Tout cela crée un tissu de surveillance diffuse. De plus en plus, on s’auto-surveille aussi : la mode du quantified self (applis et montres qui comptent nos pas, notre rythme cardiaque, etc.) illustre comment la norme du contrôle s’intériorise
books.openedition.org
Foucault parlerait de « l’intériorisation des injonctions au contrôle »
books.openedition.org
Le problème, c’est que la
surveillance confère un pouvoir unilatéral à celui qui observe. Il dispose d’informations intimes sur la personne surveillée, pouvant servir à la manipuler, la sanctionner ou la prédire. Dans un monde idéal, on voudrait que ces informations ne soient employées que pour le bien (par ex. anticiper un crime, mieux servir un utilisateur). Mais l’histoire montre que tout outil de surveillance finit tôt ou tard par être utilisé au détriment de certains, en particulier les plus vulnérables ou dissidents.
Il existe bien sûr des législations pour encadrer la surveillance : en Europe, le RGPD (Règlement général sur la protection des données) vise à redonner aux individus le contrôle sur leurs données personnelles face aux entreprises ; des tribunaux ont limité certaines lois de renseignement pour protéger la vie privée. La question de la
proportionnalité de la surveillance est au cœur des débats : jusqu’où accepter de sacrifier une partie de la vie privée et de l’anonymat pour des gains en sécurité ou en services personnalisés ?
Certains intellectuels alertent sur le risque d’une dérive vers un
technopouvoir orwellien. Par exemple, l’essayiste Shoshana Zuboff parle de « capitalisme de surveillance » pour décrire le modèle économique de compagnies qui vivent de la collecte permanente de nos données. Les citoyens, de leur côté, peuvent recourir à des
contre-mesures : chiffrer leurs communications (usage de Signal, de VPN), pratiquer l’
hygiène numérique (limiter les données qu’ils donnent volontairement sur eux), militer pour des lois plus strictes. Au niveau collectif, il existe des mouvements pour une informatique plus éthique et respectueuse de la vie privée.
Pourquoi traitons-nous la surveillance dans un dossier sur l’empouvoirement ? Parce que l’
information est à double tranchant : celle qui émancipe, c’est l’information dont on dispose pour se guider ; celle qui asservit potentiellement, c’est l’information que d’autres accumulent sur nous. On retrouve la dialectique savoir/pouvoir. Une société équilibrée devrait idéalement maximiser la première (informer les citoyens) et minimiser la seconde (les ficher). Comme l’écrit le sociologue Serge Proulx, il y a eu une promesse au départ d’Internet d’une démocratie de l’information décentralisée, mais « cette promesse se transforme peu à peu en l’instauration d’une société de contrôle et de surveillance »
books.openedition.orgFace à cela, la capacité des individus à résister, par le cryptage, le brouillage, la création de réseaux alternatifs, fait partie de leur empowerment collectif
books.openedition.org
En conclusion de cette partie, on voit que l’information est un enjeu de
pouvoir à plusieurs niveaux : pouvoir de faire (grâce à l’information) mais aussi pouvoir de nuire ou de dominer (en contrôlant l’information ou en surveillant autrui). Toute démocratie doit composer avec ce paradoxe et trouver un équilibre entre la libre circulation de l’information (source de pouvoir d’agir) et la protection contre les abus liés à l’information (source de domination). Cet équilibre passe en grande partie par la
conscience critique des citoyens et par des
garde-fous institutionnels.
À Suivre...